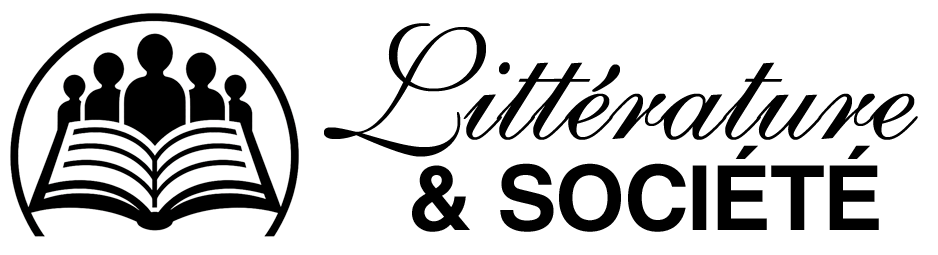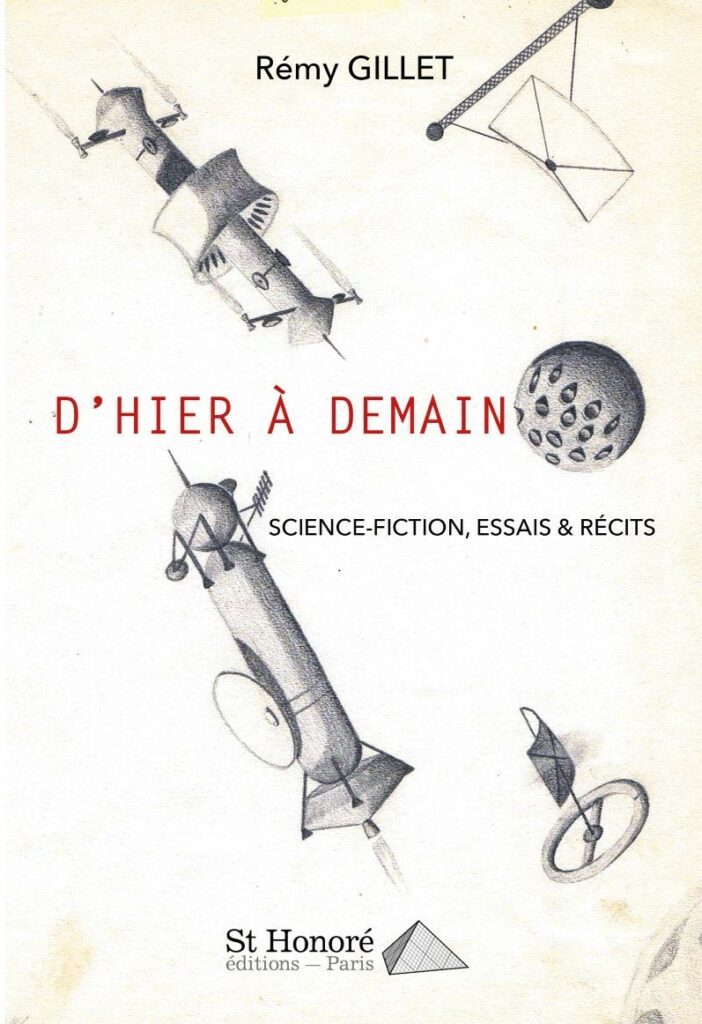
D'hier à demain : de la SF mais pas seulement
Une première partie qui donne des « coups de projecteur variés et précis » sur la Science-Fiction et sur certains de ses auteurs, comme Jules Verne et Marion Zimmer-Bradley.
Une seconde partie comportant 12 récits qui, pour la plupart, brossent du monde « des tableaux plus ou moins inattendus mais bien propres à interpeler le lecteur » : usant d’un ton plutôt détaché et parfois même désinvolte, l’auteur refuse le catastrophisme pour nous faire entrer au contraire dans le quotidien de gens qui se sont adaptés tant bien que mal aux mille dangers qui nous attendent : dérèglement climatique ; toute-puissance des technostructures ; confiance aveuglément donnée aux technologies : au-delà des menaces écologiques, sont alors abordés des problèmes comme le risque d’asservissement des individus ou les périls que court la démocratie.
Ancien professeur de Lettres en collège puis en lycée, Rémy Gillet a toujours été intéressé par la Science-Fiction : en tant que professeur de Lettres, « il a abordé le genre avec plusieurs de ses classes » ; et il a régulièrement cherché à le valoriser « par des articles dans des revues ou par des communications données lors de colloques ». Dans le même temps, il a rédigé quelques récits montrant le caractère varié de la SF : « ces documents sont à l’origine de l’ouvrage qu’il propose aujourd’hui ».
Essais et récits sur le monde à venir…… et sur l’idée qu’on s’en faisait et qu’on s’en fait encore
Première partie : regards croisés sur la Science-Fiction :
(Communications, essais et articles)
1) « La Science-Fiction, littérature de notre temps » ;
2) « Le mythe Encyclopédie dans la littérature de Science-Fiction » ;
3) « Jules Verne ou l’encyclopédisme pour tous » ;
4) « La nature dans l’Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la Science-Fiction » (encyclopédie de Pierre Versins) ;
5) « L’autre dans la littérature de Science-Fiction » ;
6) « la Romance de Ténébreuse de Marion Zimmer-Bradley » ;
7) « annexes » : « bibliographie critique » ; « lire en classe » ; « trois exemples pratiques » ; « suggestions de lecture » ; « topologie de la Science-Fiction ».
Deuxième partie : douze tableaux d’un monde en devenir :
(Récits conjecturaux)
1) « Création »
Un document inédit apporte une contribution utile au débat cosmologique ;
2) « Précisions scientifiques »
Récit rédigé collectivement dans les années 70 avec une classe de 5ème ;
3) « Publissimo »
Du le charme discret de la société de consommation ;
4) « Révolution permanente »
Ou comment toute révolution, prolétarienne ou non, peut se prendre au piège de ses propres principes ;
5) « Une journée à la ville »
Quand les réfractaires au « tout urbain » ont quand même besoin de la ville ;
6) « Insécurité »
Des pénuries en tous genres et de leurs conséquences ;
7) « Sauve qui peut »
Un remède de cheval à ces problèmes écologiques qu’on glisse sans cesse sous le tapis ;
8) « Malaise ? »
De la difficulté d’être heureux ;
9) « Ludopolis »
Rendre le monde heureux est le but de toute société : ne pas y croire est bien sûr criminel ;
10) « Béatrix, ou les prisons de la liberté »
Une autre illustration de l’inconvénient d’être né ;
11) « Cache-cache »
Des dangers de la nature… et de la culture ;
12) « Enquête sur T 232 »
De l’art d’exercer l’autorité dans un système démocratique.